De la muse à la créatrice
Catherine Pozzi, femme déterminée et rebelle, demeure pourtant encore dans l’ombre, cachée par un « grand homme », Paul Valéry. A son nom, on la qualifie de maîtresse, d’amante, et au mieux, de muse. Son œuvre se retrouve ainsi occultée : poèmes, essai philosophique et autobiographie fictive hautement inspirés, libérés de toute convention formelle ou morale. Seul son journal est mieux connu : il couvre plus de quarante années de sa vie, avec une interruption de sept ans, de 1893 – elle a dix ans – à 1934, année de sa mort.

Née le 13 juillet 1882 dans une famille de la haute bourgeoisie parisienne, elle voit défiler toutes les grandes figures de l’époque comme Sarah Bernard ou José-Maria de Heredia, dans le salon de son père, place Vendôme. La figure paternelle plane au-dessus d’elle comme une ombre à la fois fascinante et écrasante : Samuel Pozzi, célèbre chirurgien, est le premier titulaire de la chaire de gynécologie créée à Paris en 1901. Membre de l’Académie de Médecine, sénateur, il papillonne et délaisse le plus souvent Catherine dont la mère, riche héritière lyonnaise, n’est guère proche d’elle non plus. Catherine recherche donc dans son entourage des liens qui exaltent sa curiosité et un esprit insatiable : Arnaud de Gramont, docteur en physique, l’éveille aux sciences occultes ; Alfred le Chatelier, premier titulaire de la chaire de sociographie musulmane au Collège de France, lui fait lire William James, l’un des fondateurs de la psychologie moderne. C’est la porte ouverte vers le dépassement du positivisme et l’alliance du spirituelle et du matériel. Elle s’aventure alors dans la pensée d’Henri Bergson qui lui semble très vite moins prometteuse que la nouvelle science de la psychophysique fondée par l’allemand Gustav Theodor Fechner. Eprise au plus haut point d’une exigence intellectuelle insatiable et d’une pensée qui saurait résoudre les contradictions entre matière et esprit, Catherine Pozzi fait une sorte de rencontre miraculeuse avec l’étonnante Marie Jaëll. Compositrice, pianiste virtuose, elle élabore une technique innovante du toucher à partir des sciences neuro-psychologiques et révèle à son élève un monde de correspondances sensorielles qui l’enrichit d’une confiance nouvelle en ses capacités d’apprentissage.
A l’orée d’une vie spirituelle et intellectuelle exaltante, Catherine ne laisse de s’inquiéter de l’attente de ses parents et finit par se soumettre, désireuse de se rassurer elle-même, au mariage attendu. Elle voudrait être amoureuse de son mari Édouard Bourdet qui deviendra un des grands noms du théâtre de boulevard de l’entre-deux-guerres. Tandis qu’en 1909, les répétitions de sa pièce à succès Le Rubicon commencent, Catherine accouche de leur fils Claude et, affaiblie, connaît sa première crise d’infection tuberculeuse avec laquelle elle luttera toute sa vie. Edouard se sent impuissant face à cette femme d’un autre monde.
Le destin de ce mariage de deux incompatibilités est scellé sous le signe de la désillusion. Le divorce a lieu en 1921 après plusieurs années de séparation. Catherine est déjà une femme libre depuis longtemps ; elle écrit des poèmes depuis 1895 et a commencé à son essai philosophique en 1915. Toutes les conditions sont là pour faire éclater au grand jour son génie de l’écriture. Et pourtant…
« […] ce n’est pas de ta faute si tu es si loin, si tous les embêtements que tu as avec ton corps te font peu à peu oublier que cela sert au plaisir, quelquefois, ni si tu as déserté le pays des corps pour le domaine de l’âme, un domaine où je ne suis qu’un promeneur curieux qui regarde par-dessus la grille sans entrer »
Lettre d’Edouard Bourdet à son épouse Catherine Pozzi, le 29 décembre 1915. Citée par Lawrence Joseph dans sa biographie Catherine Pozzi, une robe couleur du temps, Paris, Editions de la Différence, 1988, p. 103.
Catherine Pozzi : les défis d’une écrivaine
Ironie du sort : en 1882, l’année de la naissance de Catherine Pozzi, Robert Kock identifie le bacille de la tuberculose, alors qu’elle en est atteinte dès l’âge de trente-et-un ans et qu’elle en mourra. Le journal rend compte au jour le jour de cette souffrance qui l’anéantit aux plus grands moments de son élan créateur.
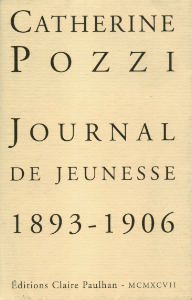
La lecture du journal est de ce point de vue édifiante : elle renforce le lecteur au lieu de l’affliger, tant l’énergie de Catherine semble mettre au défi tous les assauts de la maladie :
« Qu’est-ce qui n’est pas douloureux ? Quel instant de moi n’est pas serpent dans mes membres, corde à mon cou ? Je puis me remonter une, deux heures, comme un acrobate pour la représentation. Qu’un monsieur, qu’une dame entre… Ils ne sauront jamais. »
Ainsi écrit-elle, dans son Journal, le 26 mars 1933, juste une année précédant sa mort. Œuvre de consolation et de résilience, le journal permet à la diariste quelques bravades qui l’assurent encore de cette supériorité naturelle qu’elle a toujours ressentie.
Très jeune en effet, elle a une haute idée de sa personne, en toute lucidité ; elle s’enthousiasme de ses propres talents, quand à l’âge de quinze ans ses parents lui accordent un professeur particulier deux fois par semaine :
« Quelle veine d’avoir un prof ! Les garçons vont me respecter et je vais devenir savante ! »
Journal, 23 novembre 1896, BnF.
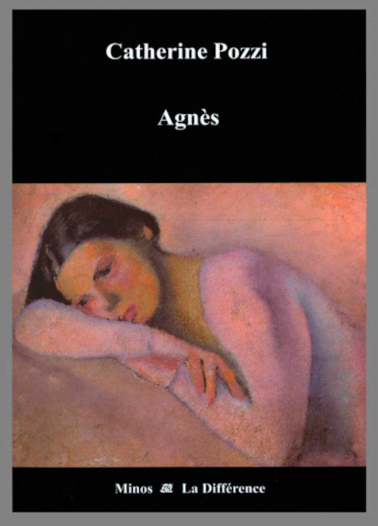
Plus tard, dans sa fiction autobiographique, elle se représente à travers le personnage d’Agnès comme une jeune fille déterminée à passer de son état actuel à un état de perfectibilité où tous les objectifs de construction corporelle, spirituelle et intellectuelle seraient atteints : « Tennis, 1ère série », « Possession de soi », « Pouvoir suivre le raisonnement le plus difficile » (In Agnès, Editions La Différence, coll. « Minos », 2002, p. 28), entre autres. Elle s’assigne un véritable programme de vie, « un devis d’architecte » selon son expression imagée, avec une détermination inflexible et exaltée.
Même avec Paul Valéry qu’elle idolâtre aux débuts de leur relation, elle mesure par moments la petitesse de son amant épris de vaines mondanités et de petits profits ; pourtant, face à lui, elle ne cesse de dévaloriser ses propres capacités intellectuelles : « J’admire votre esprit : il est pleinement ce que je suis à demi. » Pourquoi de telles doutes sur elle-même ?
Catherine Pozzi n’échappe pas à la chape de plomb de cette époque qui continue d’étouffer le génie féminin. Elle en ressent particulièrement le poids au moment de son divorce : « La loi française est le Code romain […]. L’homme y a tous les droits » (Passage d’une lettre à Fritz Kiener citée par Mireille Diaz-Florian dans Catherine Pozzi, la vocation à la nuit, biographie, Editions Aden, 2008, p. 136). On retrouve chez elle le même sentiment de frustration et la même colère que chez sa contemporaine Virginia Woolf – elles sont nées exactement la même année – dans son essai intitulé Une chambre à soi. Longtemps les femmes n’ont pu disposer dans leur propre maison d’un bureau à elle, pour se consacrer à des activités intellectuelles dans un espace qui leur appartiendrait en propre. Le bureau, c’est la pièce des hommes, du père, du mari, qui travaillent à l’abri de l’agitation familiale et mûrissent une œuvre qui leur donnera une légitimité. Cette pièce réservée au père, Catherine l’évoque comme un mirage : « Les travaux de père l’ont fait combler d’honneurs. Grand-mère et moi n’avons pas été présentes à cela : tout s’est passé à l’étage en dessous. Cinquante-six marches plus bas… C’est de ce pays fermé de tapisseries, enrichi de livres, animé de curiosités, que semblent me venir tous les rayons de la vie ; mais il est inaccessible, comme le soleil. » (Agnès, op. cit., p. 24.)
L’abîme entre la femme et l’univers de la culture, de l’émulation intellectuelle, se creuse dès les premières années puisque, contrairement à ses frères, dont Jean qui est élève au lycée Condorcet, la jeune fille ne fréquente pas d’établissement scolaire. Son éducation est celle d’une future épouse de la grande bourgeoisie : l’allemand prodigué par la bonne bavaroise de la maison, l’anglais par la gouvernante, la diction et le piano. Autodidacte, elle pioche dans la bibliothèque paternelle et se désole des leçons de littérature qu’elle reçoit dans un cours pour jeunes filles : « Heureusement… je possède une Histoire de la littérature de Lanson qui est un chef-d’œuvre […] mais pas pour les jeunes filles, ah non ! Je la lis et apprends dedans tout ce qui manque dans l’autre » (Journal, 2 décembre 1897). Mais ses ambitions intellectuelles se heurtent à son absence de baccalauréat, le sésame de l’Université. Catherine préparera seule son diplôme dont elle réussira la première partie à trente-sept ans et la totalité à quarante-cinq ans. Comment imaginer qu’une telle éducation, laissée au gré de ses envies insatiables et de son courage durablement éprouvé par la maladie, ait pu lui donner quelque confiance dans la possibilité d’une œuvre ?
La rencontre avec Paul Valéry : une chance ou une entrave ?
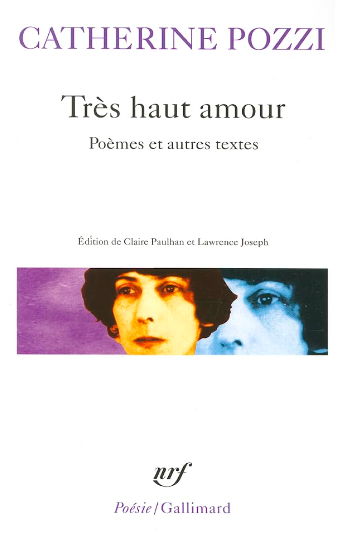
La rencontre a lieu 17 juin 1920. Le miracle de deux âmes jumelles enfin réunies se prolonge dans une passion tourmentée et chaotique jusqu’au 24 janvier 1928. Le rêve de fusion amoureuse se concrétise à la fois dans la réalité de cet amour d’une fulgurance réciproque et dans l’écriture : Catherine ébauche dès cette époque Agnès, œuvre éponyme de son propre double fictionnalisé, et, dès ce jour, son journal devient une adresse exaltée au « dearest », « dear hart » ; il ne s’écrit plus que sous la forme d’un dialogue avec son « Lionardo », son « frère chéri », son « cher cœur », son « cœur-esprit ». Car la communion de ces deux âmes unit deux vies intellectuelles, spirituelles, tout autant qu’amoureuses. Le poème « Ave », publié en 1929 mais vraisemblablement composé dès 1926, célèbre cet idéal fusionnel :
« Vive unité sans nom et sans visage,
Cœur de l’esprit, ô centre du mirage
Très haut amour. »
(Catherine Pozzi, Très haut amour, poèmes et autres textes, édition de Claire Paulhan et Lawrence Joseph, Gallimard, Poésie, 2002, p. 24.)
Le lyrisme épuré exalte la puissance quasiment divine d’un amour sublimé. Avec cette rencontre, Catherine Pozzi voit la réalisation de la philosophie qu’elle élabore depuis 1915 sous le titre initial de De Libertate, rebaptisé en 1929 Le Corps de l’âme et enfin intitulé définitivement en 1931 Peau d’âme (il faut signaler la nouvelle édition publiée en 2023 aux Editions La Vagabonde). L’idée fondatrice qu’on retrouve aussi bien dans Agnès, tient dans une aspiration à l’union harmonieuse des contraires, sens et esprit, féminin et masculin. La dimension spirituelle de la matière, du sensoriel, donne à l’être toute sa place dans le cosmos.
Mais avec Paul Valéry, épris de mondanités et soucieux de légitimité institutionnelle, la recherche de l’absolu était vouée à l’échec.
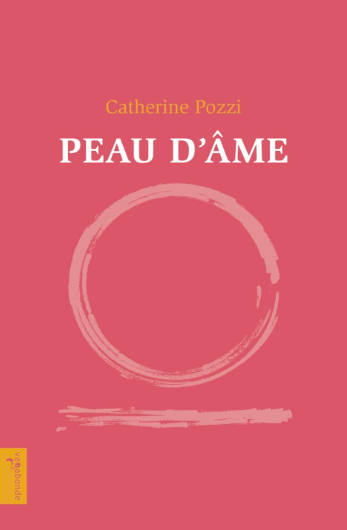
Avait-elle quelque chance d’ailleurs de se réaliser autrement que dans l’imaginaire de cette femme qui avait précédemment trouvé en André Fernet, mort au combat en 1916, l’âme sœur, éthérée, éprise comme elle d’un amour mystique ? Le 21 juillet 1914, elle lui lui confiait dans les pages de son journal :

« Vous êtes celui qui allez marcher le même chemin que moi – où nous sommes les premiers.
Catherine Pozzi, Journal, 21 juillet 1914.
Vous êtes celui à qui il faut que je fasse confiance et celui qui me remplacera si je meurs.
O André, vous êtes celui à qui je passe la petite lumière dont nous devons « faire tout le jour. »
O Prince Savant, mannequin naïf de mes 18 ans ! Amour qui auriez le mot suprême : « ton Dieu sera mon Dieu ». Mariage mystique dans le soleil. O ma compagnie à travers les étoiles. »
La mort prématurée d’André Fernet n’a pas donné le temps aux amants d’éprouver leur amour.
Mais quelques mois ont suffi pour que la rencontre avec Paul Valéry tourne au désenchantement. Les déceptions viennent ternir l’espoir d’un amour idéalisé : Pozzi, qui œuvre à son De Libertate depuis des années voit en Valéry un esprit capable de la comprendre et de partager sa pensée. Elle le lui fait lire parce qu’elle le considère comme son maître, même si elle refusera plus tard cette hiérarchie dans leur relation. La réaction de Valéry est consternante : le silence. « Quand il a lu le De Libertate, le manuscrit de 1915 – de cinq années avant que je ne sache qu’il y avait un P. V. –, il ne m’a même pas dit que cela valait quelque chose. » (Journal, 20 octobre 1922). La rencontre avec Valéry, loin de l’encourager ou de la stimuler intellectuellement, n’a peut-être fait qu’aggraver en elle le doute en ses propres capacités à réaliser une œuvre propre. Lorsqu’elle échoue à la deuxième partie du baccalauréat à l’automne 1920 et qu’elle cherche auprès de son amant la confiance qui lui manque tant, il lui propose l’immense tâche de classer ses Cahiers : honneur d’être traitée à son égal ou risque d’anéantissement de son œuvre à elle ?
Lorsque Catherine ne trouve en son amant aucun écho à l’œuvre qu’elle lui a offert en lecture, la déception tourne à la trahison : « Mon livre, je n’ai pas osé le finir parce qu’il me semblait que personne ne pouvait le comprendre. Un pourtant l’a lu, l’a compris et je n’apprends qu’il l’a compris qu’en apercevant qu’il l’a pris. » (Journal, 20 octobre 1922). Pozzi est convaincue que Valéry s’inspire de trop près de ses écrits, que des passages de son De Libertate se retrouvent dans sa préface d’Eurêka de Poe traduit par Baudelaire : « L’homme de ma vie ne dédaigne pas de réécrire le livre de ma vie après que d’avoir lu le manuscrit ». Le 4 octobre 1923 dans son journal, elle excuse finalement ce plagiat au nom de leur gémellité : « je le surprends avec horreur et délice, à inventer ce que j’ai déjà écrit dans le De Libertate. Aucune des deux n’y peut rien : nos deux têtes sont pareilles ». En écho, Paul Valéry reconnaît dans les mêmes termes, en miroir : « nos pensées sont étrangement pareilles » (Journal, 20 octobre 1922).
Autre drame du trouble fusionnel, celui de sa fiction autobiographique, Agnès : elle ne se résout à la publier que par peur d’être devancée par son amant : « je n’ai laissé faire que pour avoir compris en voyant sur un de vos cahiers de l’été une histoire analogue, que s’ils n’étaient publiés ils seraient impubliables votre histoire parue » (Catherine Pozzi, Paul Valéry, La Flamme et la cendre, correspondance, édition de Lawrence Joseph, Gallimard, 2006, lettre du 8 novembre 1929, p. 601-602). Mais elle se condamne elle-même à rester dans l’ombre de celui qu’elle soupçonne de la déposséder puisque c’est à lui qu’elle confie, pour demeurer anonyme, le soin de la publication sous les initiales mystérieuses de C.K., K pour Karin, surnom évoquant la grâce que lui attribue Valéry. A Jean Paulhan, rédacteur de la N.R.F., elle refuse de dévoiler son identité et se cache même derrière son ami le banquier Henri Fourgassié dont elle utilise l’adresse pour les échanges postaux. En cryptant son identité, en adoptant une signature asexuée[1], elle met en scène un jeu de masques avec un sonnet énigmatique qu’elle adresse à Paulhan : « je suis ombre, Paulhan ». Tant de mystères finissent par laisser croire que ce serait Valéry qui serait l’auteur, et pourquoi pas sa propre fille dont le prénom Agathe a la même initiale que Agnès ! Cette « horreur sacrée de voir mon cœur en imprimé » la condamne une fois de plus à se priver d’une légitimité à laquelle elle aspire sans pouvoir véritablement l’assumer. Elle-même ne pensait tenir son talent que de Dieu ; comment se serait-elle sentie autorisée à la signer de son propre nom ?
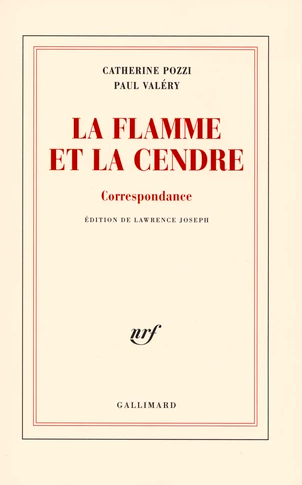
[1] Voir l’analyse de Françoise Simonet-Tenant dans son article « Catherine Pozzi masquée », in Revue de l’AIRE (Association interdisciplinaire de recherche sur l’épistolaire), n° 28, 2002, p. 93-102.

Ce portrait de Catherine Pozzi a fait l’objet de notre préface à une édition de son journal aux Editions Les Perséides en 2021. L’intérêt de cette publication, intitulée De l’ovaire à l’absolu, journal du très haut amour (1920-1928) est qu’elle recouvre toute la période de ces huit années de passion, de créativité et de tourment entre Catherine Pozzi et Paul Valéry.
Dans notre ouvrage collectif, Femmes artistes et écrivaines dans l’ombre des grands hommes (Classiques Garnier, 2019), nous avons écrit un chapitre sur Catherine Pozzi : « Catherine Pozzi, la muse trahie de Paul Valéry » (p. 99-108). Matthieu Garrigou-Lagrange a proposé quatre émissions autour de notre ouvrage pendant la semaine du 23 décembre 2019 : le lundi 23 décembre sur Catherine Pozzi , le mardi 24 décembre sur Louise Colet, le mercredi 25 décembre sur Suzanne Duchamp et, enfin, le jeudi 26 décembre sur… « Ces femmes qui écrivent« .